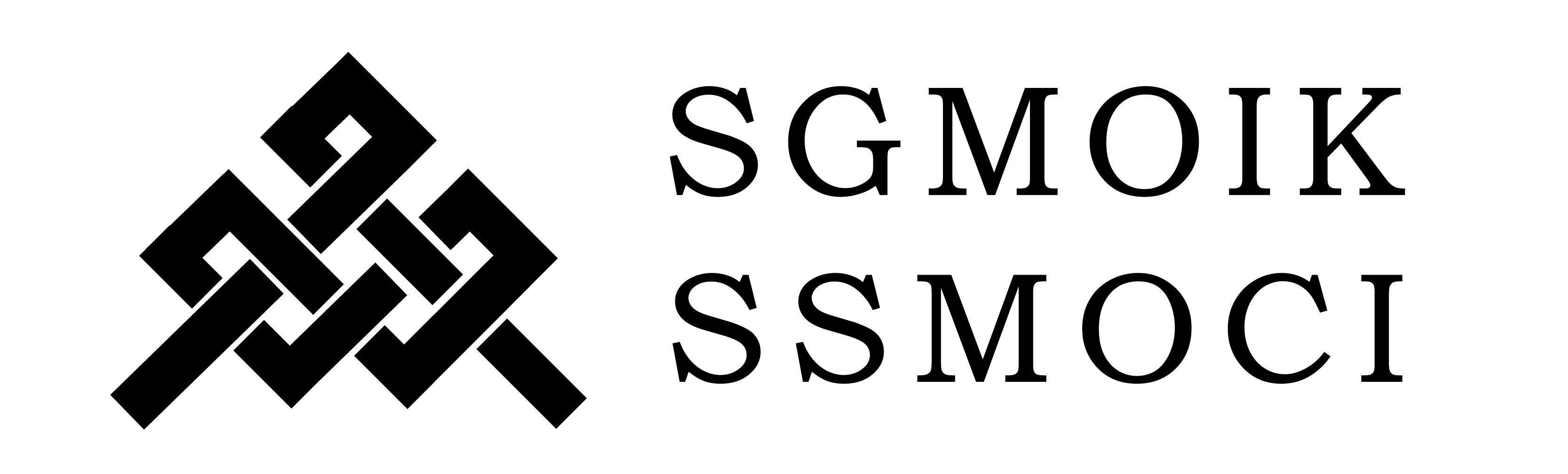Cet article est traduit de sa version originale en allemand.
Par Saddam Hamed Abu Asim
Le 2 juillet 2015, j’ai été contraint de quitter ma ville bien-aimée, Sanaa. Auparavant, je travaillais au service de presse de la présidence, j’écrivais comme journaliste indépendant pour des publications étrangères et je publiais des articles sur les réseaux sociaux. Mais après que les milices houthis ont pris Sanaa en septembre 2014, la situation est devenue de plus en plus difficile pour les journalistes : j’ai reçu à plusieurs reprises des menaces anonymes, qui se sont aggravées avec le temps. Début 2015, mon salaire a été suspendu. Des listes circulaient avec les noms de journalistes critiques envers les Houthis. Leurs services de sécurité ont commencé à me traquer : ils sont venus dans mon quartier pour demander après moi, des inconnus m’appelaient pour me proposer des rendez-vous.
Puis, en juin 2015, plusieurs de mes collègues ont été arrêtés. Certains n’ont été libérés que des années plus tard, d’autres sont toujours portés disparus à ce jour. À partir de ce moment, je me suis senti réellement en danger. Je ne suis plus rentré chez moi, j’ai déménagé sans cesse, d’un appartement à l’autre, d’un ami à un autre – jusqu’à ce que je me voie finalement obligé de quitter Sanaa.
Après une fuite longue et éprouvante, passant par Maarib et l’Hadramout, à l’est du Yémen, j’ai réussi à rejoindre l’Arabie saoudite par le seul poste-frontière encore ouvert. J’y suis resté près de cinq mois. Mais mon permis de séjour était limité, et mon travail de journaliste restreint. Lorsque j’ai été invité à une conférence à Genève, j’ai décidé de rester en Suisse. C’est là qu’a commencé une nouvelle vie – avec une langue étrangère, une nouvelle culture et des défis qui perdurent encore aujourd’hui.
Mon histoire n’est pas un cas isolé. On estime qu’environ un millier de professionnel·les des médias yéménites ont été contraints de fuir depuis 2014. Bien qu’il n’existe pas de données précises sur leurs lieux de résidence, il est clair que la plupart vivent aujourd’hui en exil – en Arabie saoudite, en Turquie, en Égypte, en Jordanie, ainsi que dans divers pays européens. Certain·es poursuivent leur travail par le biais des médias traditionnels ou numériques, tandis que d’autres ont dû abandonner leur profession – en raison de répression politique ou de précarité économique.
Ce que je décris ici est un témoignage personnel d’exil, une expérience que je partage avec beaucoup de collègues – dont le journaliste Saqr al-Sunaydi aux Pays-Bas, Abdulsalam Al-Shuraihi en Égypte et Bushra Al-Amiri en Arabie saoudite – et en même temps une analyse académique. Malgré nos conditions de vie différentes, nous partageons la volonté de rester liés aux événements du Yémen. Nous tentons toutes et tous de poursuivre notre travail, dans la mesure du possible. Et nous espérons pouvoir un jour rentrer.
Jusqu’à la guerre, le Yémen comptait douze chaînes de télévision, plus de 85 journaux et de nombreux portails en ligne
La guerre au Yémen a officiellement commencé en mars 2015, lorsqu’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite a attaqué les milices houthis, lesquelles avaient pris le contrôle de la capitale Sanaa l’année précédente. Mais les racines du conflit remontent bien plus loin, à l’époque où l’ancien président Ali Abdullah Saleh était au pouvoir, entre 1990 et 2011. Son appareil de pouvoir reposait sur un réseau d’élites militaires, religieuses et tribales. La politologue Elham Manea a qualifié ce système d’ « État rusé » (cunning state), un État qui exploitait les divisions de la société pour consolider son autorité.
Les structures autoritaires ont également marqué le paysage médiatique. Certes, une loi de 1990 garantissait formellement la liberté de la presse. En réalité, les médias restaient soumis à la censure du ministère de l’Information. Ingérences dans la couverture médiatique, retrait de licences et pressions politiques étaient monnaie courante. La tentative d’introduire en 2008 une nouvelle loi sur les médias visant à autoriser les chaînes audiovisuelles privées a échoué. Pourtant, c’est à cette époque que sont apparues pour la première fois des chaînes de télévision indépendantes du régime : Al-Saeeda et Suhail, cette dernière étant proche du parti Islah, un mouvement lié aux Frères musulmans. Toutes deux diffusaient depuis l’étranger, car le journalisme critique était pratiquement impossible à l’intérieur du pays.
Après la révolution de 2011, une brève ouverture médiatique s’est produite : de nouvelles plateformes ont vu le jour et des voix critiques ont pu s’exprimer. Jusqu’en 2014, on dénombrait douze chaînes de télévision, plus de 85 journaux et de nombreux sites d’information. Cependant, très peu de ces médias étaient véritablement indépendants, la plupart étant financés par des acteurs politiques, religieux ou économiques. Ils se sont transformés en porte-voix des différentes parties du conflit, contribuant ainsi à diviser davantage la société.
La démission de Saleh en 2011 n’a pas entraîné l’effondrement de son appareil de pouvoir. Les anciens réseaux ont perduré, tandis que l’opposition n’est pas parvenue à instaurer un gouvernement de transition stable. La Conférence de dialogue national a échoué, et dans ce vide de pouvoir, les milices houthis ont renforcé leur influence. Avec l’appui d’anciens partisans du régime, elles ont pris le contrôle de Sanaa en septembre 2014.
Ce fut un tournant. Le 25 mars 2015, une coalition militaire menée par l’Arabie saoudite est intervenue à la demande du président de l’époque, Abd Rabbo Mansour Hadi. Le Yémen a alors sombré dans une guerre complexe. Le pays s’est morcelé en zones d’influence rivales, chacune poursuivant ses propres agendas politiques et médiatiques.
Les médias ont été particulièrement touchés. Entre 2015 et avril 2024, le Syndicat des journalistes yéménites et la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ont recensé plus de 2000 violations commises à l’encontre de professionnel·les de l’information : arrestations, tortures, assassinats ciblés, fermeture de 165 sites internet (dont beaucoup créés après 2014 mais sans autorisation officielle), ainsi que 38 cas de confiscation d’équipement journalistique. Les principaux responsables de ces abus sont les Houthis (1178 cas), suivis par le gouvernement reconnu à l’international (376) et le Conseil de transition du Sud (113).
Le « migrant connecté »
Les Nations unies estiment qu’environ cinq millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du Yémen depuis le début de la guerre. Presque autant vivent aujourd’hui à l’étranger : certains avaient émigré avant la guerre pour des raisons économiques, d’autres ont fui après 2015 à cause de la violence. Pourtant, seuls quelque 70000 réfugiés sont officiellement enregistrés auprès de l’ONU, ce qui témoigne de la situation juridique précaire de beaucoup d’entre elles et eux, ainsi que du manque de données fiables sur la diaspora yéménite.
On sait que la majorité des Yéménites se trouvent aujourd’hui en Arabie saoudite et dans d’autres pays du Golfe, puis en Égypte, en Turquie et en Jordanie. La diaspora yéménite est également en croissance en Europe et en Amérique du Nord. Le fait qu’autant de Yéménites vivent désormais hors de leur pays se reflète de plus en plus dans le paysage médiatique.
Selon un rapport du Economic Media Center publié en 2018, environ 700 journalistes yéménites ont quitté leur lieu de vie et de travail en raison du conflit : environ 490 d’entre elles et eux ont fui à l’étranger, tandis que les autres se sont déplacés vers des zones plus sûres à l’intérieur du pays. Aujourd’hui, on estime à plus de 1000 le nombre de journalistes en exil, ce qui témoigne de l’ampleur des dégâts causés par la guerre dans le secteur des médias.
Après que les Houthis ont pris le contrôle des médias d’État, le gouvernement reconnu à l’international a réactivé son appareil médiatique depuis Riyad. Des chaînes de télévision privées yéménites ont également transféré leur siège à l’étranger – notamment en Arabie saoudite, en Turquie, en Égypte, aux Émirats et en Jordanie – tandis que de nouvelles chaînes y voyaient le jour. Leurs lignes éditoriales reflètent en grande partie les positions politiques de leurs bailleurs de fonds ou des pays hôtes.
En parallèle, un paysage médiatique numérique diversifié s’est développé en exil : des portails d’information, des podcasts et de petits centres de recherche ont vu le jour. Un grand nombre de journalistes yéménites sont restés actifs sur les réseaux sociaux. Beaucoup travaillent désormais de manière indépendante. Même celles et ceux qui ont dû se reconvertir dans d’autres métiers continuent, pour nombre d’entre elles et eux, à suivre de près la situation au Yémen.
Malgré la séparation géographique, les personnes migrantes participent activement aux évolutions sociétales de leur pays d’origine à travers les réseaux numériques – un phénomène que la sociologue Dana Diminescu a décrit par le concept de « migrant connecté ».
Les trois journalistes yéménites présentés ci-dessous en sont des exemples typiques : ils poursuivent leur travail via des plateformes numériques et des médias alternatifs, créant ainsi un espace public transnational pour les questions yéménites, à l’abri de la censure étatique. Malgré des défis persistants – accès limité à l’information, portée restreinte, obstacles juridiques – les professionnel·les des médias en exil restent ainsi liés à leur pays d’origine et s’efforcent de porter sa voix à l’extérieur.
Saqr al-Sunaydi : dans ses textes, il relie ses origines yéménites à sa nouvelle réalité européenne
Le journaliste yéménite Saqr al-Sunaydi estime que tous les journalistes de son pays ont connu la répression. Âgé de 46 ans, il a lui-même échappé de justesse à une arrestation début 2015. Il préparait alors un reportage pour la chaîne d’opposition Belqees. Son micro, orné du logo de la chaîne, a éveillé la méfiance. Des agents de sécurité se sont approchés de lui et lui ont interdit de continuer à filmer. Il s’est enfui avant l’arrivée d’une autre unité.
Après des études de journalisme à l’université de Sanaa, al-Sunaydi a d’abord travaillé pour des journaux locaux. Il a ensuite rejoint la chaîne Belqees. Lorsque celle-ci a dû s’exiler en Turquie en mai 2015, il a lui aussi fui, menacé par la répression des milices houthis. Depuis 2014, explique-t-il, la priorité des journalistes au Yémen n’est plus de rechercher la vérité, mais simplement de survivre.
En Turquie, il a poursuivi son activité comme rédacteur et producteur. Mais le contact direct avec les gens lui manquait. Au lieu d’entretiens sur le terrain, il devait désormais se contenter de conversations téléphoniques et de messages. Sa situation était difficile : permis de travail temporaire, revenu limité et un profond sentiment de déracinement.
C’est durant cette période qu’il a écrit son roman « Le voyage de Rāfat – Toutes les promesses faites en chemin sont des mensonges ». L’histoire raconte la fuite d’un jeune Yéménite vers l’Europe, avant que la guerre n’éclate dans son pays. Même s’il ne le dit pas explicitement, il semble y raconter en filigrane sa propre expérience.
À la mi-2023, al-Sunaydi s’est exilé aux Pays-Bas, où il a dû affronter de nouveaux défis. En Turquie, c’était surtout l’incertitude liée à son statut de séjour qui le préoccupait ; aux Pays-Bas, il s’est heurté avant tout à la barrière de la langue – et, avec elle, à la difficulté de s’intégrer dans son domaine professionnel.
Bien qu’il ait passé près de deux ans dans un camp de réfugiés en attendant sa décision d’asile, il est resté actif. Il a participé à des événements locaux et s’est efforcé de tisser un réseau dans son nouvel environnement.
Des journalistes néerlandais se sont intéressés à son histoire, ce qui l’a aidé à se faire une place dans le paysage médiatique local. Il a appris le néerlandais et a commencé à écrire bénévolement comme chroniqueur pour Omroep Almere, un magazine offrant une tribune aux personnes migrantes. « Les gens ne veulent pas de copies, ils cherchent de nouvelles perspectives », dit-il. Dans ses textes, al-Sunaydi relie ses racines yéménites à sa nouvelle réalité européenne. Dans une chronique, par exemple, il compare la lune au Yémen – symbole de beauté féminine – avec le ciel souvent nuageux des Pays-Bas. Pour lui, une manière d’illustrer comment la nature et le climat façonnent nos perceptions.
Il apprécie certes la liberté que lui offre l’exil : des textes qui auraient été dangereux à publier au Yémen peuvent désormais être diffusés librement en Europe. Mais la nostalgie du pays natal reste vive. « Plus le temps passe, plus elle s’intensifie », confie Saqr al-Sunaydi. Il critique aussi les médias yéménites en exil, dont beaucoup ne s’adressent qu’au public resté au pays. Selon lui, il manque des traductions et un véritable dialogue avec le monde extérieur. C’est ce qui l’a conduit à participer à un programme de formation du média néerlandais RFG Media, une organisation créée par et pour des journalistes réfugiés. L’objectif est de produire des contenus capables de franchir les barrières culturelles – et ainsi rendre les voix yéménites audibles et visibles.
Bushra Al-Ameri : un engagement pour les droits humains malgré des conditions difficiles
L’expérience de Bushra Al-Ameri illustre la complexité de l’exil journalistique, où les défis professionnels se mêlent à des restrictions liées au genre. Les femmes journalistes bénéficient rarement des mêmes opportunités que leurs collègues masculins lorsqu’il s’agit de formations, de voyages professionnels ou de postes de responsabilité dans les médias publics. Elles sont aussi souvent les premières cibles des campagnes de diffamation ou des accusations de manque de loyauté.
Depuis son départ du Yémen en 2015, elle vit dans la capitale saoudienne, Riyad. Sa vie y est loin d’être simple. En plus des obstacles professionnels, elle doit composer avec un statut de séjour précaire et un revenu faible et irrégulier. Beaucoup de ses collègues doivent travailler dans des médias proches du gouvernement ou occuper des emplois sans lien avec la presse pour subvenir aux besoins de leur famille.
Al-Ameri décrit la situation professionnelle à Riyad comme la continuité du système politico-médiatique qui prévalait déjà au Yémen : dominé par des logiques de loyauté, mais sans protection légale ni institutionnelle.
Malgré ces conditions difficiles, cette journaliste de 46 ans poursuit son activité et s’engage pour les droits humains. Elle produit l’émission hebdomadaire Al-Shahid sur la chaîne de télévision du gouvernement yéménite reconnu à l’international, basé à Riyad. Ce programme documente les violations des droits humains au Yémen – en particulier dans les zones sous contrôle houthi. Elle dirige également le Independent Yemeni Women Journalists Network, un réseau de journalistes yéménites indépendantes, et gère le site d’information Al-Yemen Al-Ittihadi, consacré aux questions sociales et de droits humains.
Bushra Al-Ameri s’efforce de suivre de près les évolutions dans son pays natal. Elle rêve d’y retourner et de pouvoir y exercer à nouveau son métier sur le terrain. Mais les expériences traumatisantes de certaines journalistes revenues au pays – harcelées, arrêtées et parfois torturées – ainsi que son souci de protéger ses enfants l’en empêchent. « Dès que mes enfants auront terminé leurs études et seront indépendants, je retournerai au Yémen. Je préfère mourir auprès des miens que seule à l’étranger. »
Abdulsalam al-Shuraihi : poussé à légitimer le coup de force des Houthis comme une « révolution juste »
L’expérience du présentateur de télévision Abdulsalam al-Shuraihi, 41 ans, diffère à certains égards de celle des autres journalistes. Car lorsque la guerre a éclaté en 2015, il est resté au pays – il n’a quitté Sanaa qu’en 2022, lorsqu’il n’a plus vu d’autre issue.
Au moment de la prise de pouvoir par les Houthis, al-Shuraihi travaillait pour la chaîne indépendante Al-Saeeda. En 2015, la milice houthi a fermé la chaîne. Al-Shuraihi est alors resté chez lui. Il ne songeait pas à partir – il ne savait tout simplement pas où aller. Peut-être espérait-il, comme tant d’autres, que la situation finirait par s’améliorer.
Un an plus tard environ, il a fondé sa propre société de production, spécialisée dans les courts-métrages et la publicité. Mais la milice lui a imposé des impôts et des taxes toujours plus lourds, qui dépassaient bientôt ses revenus. En tant qu’animateur de télévision populaire et connu d’un large public, il a par ailleurs été plusieurs fois pressé d’apparaître sur des chaînes proches des Houthis, afin de présenter leur coup de force comme une « révolution juste ». C’est ce qui l’a finalement décidé à partir. Il a vendu sa maison et sa société, puis s’est installé au Caire. Là, il a participé au lancement de la nouvelle chaîne Al-Jumhuriya, avant de rejoindre Yemen Today, où il travaille encore aujourd’hui comme animateur et directeur de programmes.
Au Caire, les réseaux sociaux – en particulier Facebook – sont devenus son principal lien avec le public. Car les médias en exil, explique al-Shuraihi, sont souvent liés à certains acteurs politiques ou partis, ce qui conduit à une déformation de messages essentiels au profit d’agendas politiques.
Al-Shuraihi affirme qu’en Égypte, malgré les difficultés financières et les problèmes liés au droit de séjour, il jouit d’une certaine liberté : il a pu construire une communauté fidèle grâce à ses réseaux sociaux et s’exprime régulièrement sur l’actualité. Il reste néanmoins convaincu que la voix de l’exil perd souvent de sa force, faute de proximité avec le pays d’origine.
Le journalisme yéménite a une voix
Les récits de ces trois journalistes que j’ai rencontrés montrent qu’un exil n’est pas seulement un déplacement géographique. C’est une expérience complexe, qui redéfinit à la fois l’identité professionnelle et personnelle. Malgré des conditions de vie très différentes – que ce soit à Riyad, au Caire ou à Amsterdam – ces journalistes partagent la même préoccupation pour leur pays, le même désir de rester fidèles à leur métier et le même besoin de maintenir le lien avec un public perdu.
Si les réseaux sociaux sont devenus notre principal outil pour conserver cette connexion, les histoires que nous y racontons sont multiples – et les conditions de l’exil varient d’une personne à l’autre. Ce qui nous unit, c’est la conviction que le journalisme yéménite a une voix, même si celle-ci s’exprime aujourd’hui principalement depuis l’étranger.
Saddam Hamed Abu Asim est un journaliste et militant yéménite installé en Suisse. Après avoir obtenu son diplôme à la faculté de médias et de journalisme de l’Université de Sanaa en 2006, il a travaillé pour des dizaines de journaux locaux et internationaux. Depuis son arrivée en Suisse en 2016, il poursuit ses activités dans le domaine des médias et des droits humains et participe régulièrement aux sessions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Il a collaboré avec plusieurs institutions suisses, dont la Croix-Rouge suisse, le Musée historique de Berne et le Musée de la communication. Il poursuit actuellement un master en études moyen-orientales à l’Université de Berne, consacré aux journalistes yéménites en exil en Europe.
Image (page d'accueil) :
La journaliste yéménite Bushra Al-Ameri vit et travaille dans la capitale saoudienne, Riyad. Elle produit notamment l’émission hebdomadaire Al-Shahid à la télévision du gouvernement yéménite internationalement reconnu, basé à Riyad.
Image : privée
Bibliographie complémentaire
- Manea, Elham. Yemen’s Cunning State: Outsmarting the Cunning State. NOREF Report. Oslo: Norwegian Peacebuilding Resource Centre, 2012.
- Lackner, Helen. Yemen in Crisis: The Road to War. London: Verso, 2019.
- Diminescu, Dana (2008). The Connected Migrant: An Epistemological Manifesto. Social Science Information, 47(4), 565–579.
- Shuja Al-Deen, Maysaa. The Long Shadow of War: Mobilization Dynamics of the Yemeni Diaspora since 2011. Arab Reform Initiative, 26. Mai 2025. The Long Shadow of War: Mobilization Dynamics of the Yemeni Diaspora since 2011 – Arab Reform Initiative
- Pernot Ali, M. B., Almajali, S., Aljabzi, M. N., & Lauret, A. What War Does to Yemeni Migration. Arabian Humanities (20). Zugriff am 26. Mai 2025. https://journals.openedition.org/arabianhumanities/15052
- Jemenitische Journalisten-Gewerkschaft: Mehr als zweitausend Verstösse gegen die Pressefreiheit in zehn Jahren Krieg. 03.05.2024. Zugriff am 11. Mai 2025. عقد أسود للحريات .. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات | نقابة الصحفيين اليمنيين
- Studies & Economic Media Center (SEMC). Mapping Yemeni Journalists in Exile. Taiz, Yemen, 2024. Zugriff am 22.07.2025 Yemeni-Journalists-mapping-English.pdf